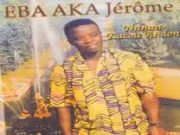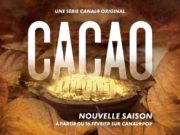Il faut reconnaître à Tidjane Thiam suite à son interview sur TV5 un talent rare, presque spectaculaire, celui de faire du vide une promesse, de l’absence une vertu, et du désengagement une vision.
À l’écouter et à le voir désormais prétendre incarner l’avenir d’un parti qu’il a longtemps tenu à distance respectable, l’on croirait qu’il a traversé les années ivoiriennes tel un prophète en exil, dont l’éloignement ne serait pas fuite mais formation mystique, purification politique, ou mieux, le recul stratégique d’un génie solitaire préparant son grand retour.
Le paradoxe Tidjane Thiam
Entre 1993 et 1998, au lendemain de la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, alors que la Côte d’Ivoire entamait sa délicate navigation post-houphouëtienne, Tidjane Thiam n’était pas l’absent flamboyant d’aujourd’hui.
Il était là. Présent.
Responsable du Bureau National d’Études Techniques et de Développement (BNETD), bras droit technique de Henri Konan Bédié.
La légende personnelle que l’intéressé se construit aujourd’hui omet avec une légèreté savamment calculée que c’est sous son regard expert que l’héritage social d’Houphouët a commencé à s’effriter, non sous la pression des seules contingences économiques, mais par le triomphe assumé d’une logique ivoiritaire, dépourvue de cette fibre humaine qui faisait toute la singularité du père de la nation.
L’héritage de Houphouet Boigny, un arbre mutilé par le PDCI
De 1993 à 1998, Tidjane Thiam n’était pas un spectateur, mais un ministre d’abord au Plan, puis à la Construction. Et c’est sous sa co-direction que le système éducatif, naguère colonne vertébrale de l’élévation sociale, a entamé sa chute : réduction des budgets, gel des recrutements d’enseignants, croissance démographique non anticipée, effondrement du taux d’encadrement. L’université, autrefois temple du savoir et de l’émancipation, sombrait dans les grèves, le surpeuplement, l’indifférence.
Les structures sanitaires, auparavant pilier du contrat social ivoirien, commencèrent à pâtir des fameuses « études de faisabilité », qui remplacèrent les dispensaires par des rapports, et les soins par des chiffres.
Thiam n’a pas détruit seul, mais il a contribué à fragiliser un édifice patiemment bâti pendant trois décennies. Là où Houphouët construisait dans la durée, avec la lenteur stratégique d’un bâtisseur d’Empire, Tidjane administrait en consultant, sous la supervision froide de ses dirigeants de Mackinsey. De 1993-1994 Tidjane Thiam contrairement à la croyance enseignée à ses disciples, il ne fut pas le chirurgien du système de l’Etat providence ivoirien hérité de FHB, il en fut le technicien zélé, le cartographe sans boussole, le rationalisateur insensible.
Houphouët-Boigny ou trente ans pour façonner un État
Qu’on ne s’y trompe pas : Houphouët-Boigny n’a rien bâti en cinq ans.
Il a patiemment modelé la Côte d’Ivoire sur plus de trois décennies, avec une vision enracinée dans le temps long, la stabilité institutionnelle et l’accumulation progressive des infrastructures.
L’école gratuite, les bourses, les centres de santé dans les moindres sous-préfectures, les routes bitumées serpentant jusqu’au plus reculé des village, etc, Tout cela, c’est le fruit de trente années de constance, pas d’un coup de baguette magique réformiste.
C’est aussi parce qu’il est resté physiquement, politiquement, émotionnellement qu’il a pu bâtir.
Or, Tidjane Thiam, lui, revendique son éloignement comme un gage d’intégrité. Ce qui, chez tout homme politique sérieux, passerait pour un handicap majeur, une absence prolongée de plus de vingt ans du pays, sans engagement direct dans ses douleurs, ses échecs, ses transformations, devient chez lui un argument inversé, une sorte d’innocence par abstention.
Quand l’exil devient vertu, la sociologie du mirage
Il faut saluer ici une prouesse intellectuelle rare : transformer une absence prolongée en atout politique.
C’est un peu comme si l’on se vantait de n’avoir jamais élevé ses enfants pour prétendre ensuite mieux les comprendre, au nom d’un détachement supposé lucide.
Tidjane Thiam tente ainsi de présenter son éloignement comme une neutralité sociale, un détachement de caste, qui l’élèverait au-dessus des querelles locales, des fidélités usées, des rancunes politiques.
Mais cette posture, en réalité, sonne creux. Car l’absence n’est pas synonyme de pureté. Elle est désengagement. Et dans un pays où la souffrance collective a été palpable, incarnée, violente, se taire pendant vingt ans, c’est aussi consentir. À défaut d’avoir parlé, il aurait pu servir, il aurait pu agir. Il ne l’a pas fait.
Le mirage de l’expertise décontextualisée
En invoquant son parcours international comme une carte de visite indiscutable, Thiam tente de substituer l’éclat du C.V. à la légitimité du terrain. Mais ce que l’on oublie trop souvent, c’est qu’aucune expertise, aussi brillante soit-elle, ne remplace la connaissance charnelle d’un peuple, de ses douleurs et de ses espoirs. Le pays réel ne se gouverne pas depuis les tours vitrées de Londres ou les parquets cirés des banques suisses.
Il ne suffit pas d’avoir piloté des portefeuilles d’assurance et d’avoir fréquenté les salons feutrés des institutions pour comprendre la détresse d’un paysan de Sinématiali ou les attentes d’un instituteur de Gagnoa.
Ce qu’il faut, ce n’est pas seulement de l’intelligence, c’est de la mémoire, de l’humilité, du contact, de la responsabilité dans l’histoire.
La brillante vacuité d’un héritier qui n’a pas connu la maison
Tidjane Thiam se présente aujourd’hui comme l’héritier crédible d’un parti qu’il n’a pas connu de l’intérieur, et le restaurateur d’un système qu’il a contribué à abîmer.
Il parle de réformes sans reconnaître les responsabilités passées, s’arroge le legs d’Houphouët sans en avoir partagé les fondations, et revendique une neutralité dont on ne sait si elle est indifférence ou opportunisme.
En vérité, il n’est ni bâtisseur ni réformateur, il est le manager d’une fiction politique, soigneusement emballée pour un électorat que l’on croit amnésique.
Mais la Côte d’Ivoire, elle, n’a pas oublié. Elle sait qui était là quand les hôpitaux fermaient, quand les écoles se dégradaient, quand la nation doutait.
Et elle reconnaît, sous les vernis du discours policé, la voix ancienne de ceux qui n’ont pas été là quand il le fallait, mais qui veulent désormais être partout parce qu’il est trop tard.
Kalilou Coulibaly Doctorant EDBA, Ingénieur